(Pour la construction graphique des textes ci-dessous, vous avez la possibilité de télécharger la page au format Doc : Word, disponible dans la page de téléchargements )
marché au maroc inachevé
Marcher dans le temps dissolvant du désert.
Ce maroc.
On débarque au sein d'un naturel sans fard, entre terres nues et
ciels nus.
Ça vous regarde...
Des gens qui marchent autour et qui laissent leur corps aller. Le grand
large léger somnambulise leur train de vie.
On avance à boulets lourds, abandonne ici tout désir, puis
peu à peu d'un pas à pas passif parmi les pierres, ni vent,
ni chaleur forte, mais une lente levée de terres devant, aux crêtes
usées rieuses, dressées sans hystérie ni tension, dans
une douceur qui nous paraît sournoise et imprévisible.
Il y a devant moi de la terre montée en croûte,
des gris vers le bas ravinés,
des doigts de dinosaure aux pattes des collines,
et ce dur, ce redoutable fond qu'au lieu d'éviter on affrontera amoureusement.
Gouffres se tendent et souffles tirent.
Des terres rideuses, des terres pourtant juvéniles,
qui rient dans leurs plis, et sans la moindre effervescence.
Douceur au fil de leur formation tourmentée.
Le sec fait rage aujourd'hui après les réguliers ravages des
eaux arrachant tous les sols.
Enfants
Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo !
Donne-moi un stylo !
Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo !
Après cette entrée en matière, seras-tu plus jubilant
? Quand tout ça aura caressé ta voix dans l'intérieur
?
Des signes à d'autres signes qui se seront ajoutés, rien de
plus.
On voudrait ne pas voyager pour rien.
Alors on marche en se chargeant de tout ce qui vient à la vue.
Impression de suivre le panorama, d'avoir à l'œil la moindre
pierre.
Guide
Le jeune homme qui nous mène connaît le classique des pérégrinations.
Ni romantique dans sa parole, ni tragique dans son existence, c'est un conservateur
efficace. Il tire avec lenteur sur la promenade pour faire durer la zone
qu'on traverse du paysage. Son sang d'entremetteur ne bondit pas. Le pied
enlainé dans sa sandale, il marche au pas, régulier et rassurant.
Mulets
À voir comme on les charge, on s'affole de la tyrannie des maîtres.
(Des blancs, d'autres au poil sombre). On leur pressure l'échine.
Mais le muletier veille à l'équilibre des masses, puis tire
en forçant sur les sangles. Si la bête ne mutine pas, le parcours
se fera concertant.
Charge
Légumes, oranges, épices, bidons d'eau.
Casseroles, assiettes.
Avoine.
Tentes, tapis, sacs de toiles.
Cordages.
Tout sur le bât. Et l'homme monté dessus laisse comme si aller
ses quatre pattes.
Quittant le village, nous serons suivis par des enfants mendigots. Ils tenteront de nous faire lâcher quelque chose. N'importe quoi qui vienne de l'autre monde. Quémandeurs obstinés qui cherchent en nous la faille d'une compassion. (Leurs pieds chaussés pauvrement résument nos conforts et nos privilèges. Leurs pieds, courroucés par les dix mille pierres du chemin, semblent, à la longue, avoir trouvé une entente avec elles). Ils nous demandent l'extraordinaire objet qu'on leur jalousera. Mais donner serait s'emmieller et rendre folles toutes ces mouches. Et c'est pesant d'avancer comme ça, assailli par la même question poisseuse, espèce de supplique qui vous rend à vous-même insupportable. On a hâte de gagner notre propre désir de rien. Les dernières bâtisses se raréfient. La vue se décharge. De guerre lasse, les enfants nous abandonnent au désert. On est saisi tout à coup d'un vaste soulagement.
Marcher, mais on voudrait écrire.
Impossible de concerter les deux.
Écrire après coup c'est avoir trop perdu
Ne restent que des épaves, des visions mortes.
Le monde que donne l'enthousiasme à l'écrire devient nécropole.
Mais j'ai pris le parti de vivre corps et âme dans le joyau.
Marcher.
Ici.
Ni comme espion, ni comme ennemi, ni comme étranger.
Simplement joindre ma propre matière à la matière du
lieu
dans le même noyau.
Alors mon souffle devient celui du sol,
ma couleur de peau mime joyeusement les blondeurs de la roche…
Je baigne en tout ce qui passe.
Et la merde que je ferai sera juteuse, ardente,
comme un rendu de grand merci au saoulant désert.
Personnages
Grande et volubile, Patricia a des cheveux vikings tirés en chignon.
Son ironie dans les mots vous tire dessus en riant. Ça parle sans
malfaçons, ça croise et mélange vides et pleins avec
dextérité. On court derrière et on chute. Et quand
elle marche, c'est une rondeur qui se moule dans le volume des collines
ou le pli des vallées.
Yves est son mari. Si amalgamé au désert que sa doctrine est le rien dire. Au contraire, il retient. Il est appareillé pour varier les prises de vue. Noir et blanc plutôt que la couleur jugée inesthétique par excès de vérité. C'est un promeneur raide et droit. Le pas métronomique, il déambule partout comme ça, nonchalant et aux aguets. Il déambule en mâchonnant l'espace, économe de son pas, qu'il a rigoureusement identique à lui-même, très rigoureusement.
Je m'abstiens de prendre des notes comme autrefois.
Peur de divaguer ou de péter des impostures dans ce no man's land.
Il n'y a de bruit que le bêlement de brebis.
Et parfois mon sifflement imbécile dans l'oreille.
Toujours le même sifflement qui pique en continu le côté
gauche de la tête.
Mais dans la tête même surgit parfois le roulement d'un râle,
Un mur de mots cassant le miracle audacieux du paysage.
Ça empêche de jouir.
C'est peut-être ces enfants pouilleux qui me nasillaient leurs refrains.
Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo !
Donne-moi un stylo !
Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo !
Et tout le paradis pustule avec ça.
Écrire… On ne sait pas comment. Les mots ne sont que pure
tartufferie au regard de ça ! (Cette nature crue qui dépoisse
le corps). Ils feraient fuir le beau chaos alentour à mesure que
je mettrais mes pas en pages. Comme s'ils abâtardissent les croisements
que les choses font au-dedans de soi en cours de marche.
On ne sait pas comment s'y prendre. Et faute de mieux, il faudra s'obliger
à séparer les deux activités. D'abord, en se laissant
aller au fil de son parcours, passant tout entier dans la puissance du site.
Puis, le voyage terminé, reversé dans le confort du domicile,
je me ferai le grapheur, après coup, de cette pérégrination.
Le premier campement
Un terrain bas et des collines tout autour. Nous serons à l'abri
du vent. Les mulets libres de corps cavalent, l'âme en folie tout
à coup. Mais les hommes, pas sots, ont noué à une patte
une longue corde qu'il sera facile de saisir. Il n'empêche. Les hystériques
galopent en tous sens en réponse à leur sang, ou bien se roulent
dans la poussière, ou bien encore se câlinent du col mutuellement.
Nous dégageons les pierres et nous dressons les tentes.
Tout près, un filet d'eau exténué d'où monte
un chant de batracien. On imagine, en période de pluie, la hargne
intense des eaux débourrant de tous côtés pour arracher
au passage le moindre morceau de rive dans une hurlerie de tremblement de
terre.
Tandis que le ciel tombe, juste avant leur première nuit, les amoureux
romantiques se lancent à l'assaut de la plus haute colline posée
en est pour s'empiffrer à la grande saignerie du couchant. C'est
ardent comme un pourrissement d'or à vue d'œil. Déchirements
de nuages, cantate et convulsion de formes unanimement muettes. Comme des
frémissements d'abîmes profonds, comme une profusion de flottilles
en plein naufrage d'où naissent des sangs. Les yeux restent possédés
et hagards. Ni transe, ni extase. Mais l'omnipotent décor vous rend
mince, si mince que la grouillerie mentale des mots, désemparée,
remue à peine sous l'exquis ruissellement qui avale ceux qui ont
osé grimper jusqu'ici. La clarté s'appauvrit et monte l'effroi
qu'à tout instant tombe la nuit totale, on retourne vite au camp
de crainte que la pente ne s'encre définitivement d'obscurité.
À mi-chemin, Fabien baise au front sa Fabienne. Après quoi,
il se tiendra debout en gardien de pudeur, tandis que sa baisée aura
disparu, profitant d'un accident de terrain, pour se défaire.
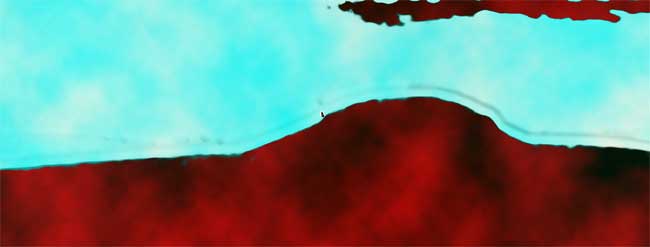
Personnages
Au début, on ne savait pas. Qui était avec qui ? Qui le frère
de qui ? Qui l'ami ? Qui l'amant ? Un groupe de quatre avec les mêmes
mots, la même rigolade à fleur d'esprit, une même façon
de s'habiller baroudeur mais non baroudé. Quarteron de cul et chemise,
quoi ! Fabien, cheveu court, a des airs de tintin étonné.
Il porte l'écharpe longue en nœud coulant autour du cou. Il
lancera des fusées à faire sauter les pierres du chemin. Et
puis c'est le type à Fabienne. Des années qu'ils vivent à
la colle. Ensemble par monts et par vaux, et l'un de l'autre embourriqués
mais assez raisonnablement pour ne pas sombrer dans un ménage officiel.
On ne les voit pas marcher forcés à perpétuité.
Histoire de ne pas se damner à l'esclavage. Rien qu'une mutualité
moderne d'embrassements mi-attendris et mi-distants.
Bastien, c'est le frère de Fabienne. Il traîne la patte. C'est
venu comme ça, dès les premières mises en jambe. Et
depuis, il stoïcise à visage fermé. Mais le mal va lui
serrer les poings de plus en plus. La jambe se raidira sur le moindre caillou.
Seul dans la confidence, le quartet obligera le guide à ralentir.
On envisagera même d'asseoir le malade sur une mule. Le second jour
à midi, le maître muletier, mis au courant du mal, sortira
tout l'arsenal de son savoir. Et le voici qui malaxe Fabien à la
main droite. Le malheureux se tortille comme essoré sur place, s'agrippe
au sol, massacré à blanc par son redresseur. Les rires autour
roucoulent au spectacle du tripatouillé. Étienne, le dernier
des quatre, exhorte son compagnon à la résistance, tandis
que les moins apitoyés de l'assemblée mordent au pain qui
vient de leur être apporté
Écrire, il le faudrait comme on voyage.
Mais voilà bien l'impossible.
Reste alors à tout mêler comme ça nous vient dans l'écriture,
et comme un autre voyage, immobile et recomposé.
Car les mots rendent le monde non comme il est mais comme ils sont eux-mêmes.
Ils font à leur manière histoire de tout.
Ils violent les choses en ahanant sans jamais nuire à leur virginité.
Vision de l'Atlas
Voici l'Atlas blanc sur l'au-delà des hautes terres. Inaccessible
à dire. Nous le suivrons des heures, enragés de nous rincer
l'œil sans jamais l'épouser. Une longue sinuosité de
glace sur laquelle à peine si le ciel est posé. Contreforts
ondoyants piqués d'arbres et vallée rouge, rongée par
les eaux. Petite vie en suspens, je m'abreuve au bienfait de ce paysage.
Ivre doux, je me contiens car je suis à deux doigts de m'embraser
d'une grande idée métaphysique. Je me sens massacré
par la torrentielle ardeur du temps, imbécile comme un citadin dévoyé.
Qu'est-ce donc que nous faisons-là ?

L'enclos
Maintenant, à mesure que l'on marche, on entend fuser des bêlements
dans tous les coins. On imagine une bergerie berbère. Et en effet,
nous nous trouvons bientôt dans un fond de vallée avec moutons
noirs, moutons laineux, moutons sales qui s'éparpillent en paniquant
à notre approche. Des chiens se donnent un mal fou pour faire dévier
nos pas. Des yeux par milliers, regards méfiants, nous interrogent
sur nos origines. Les brebis traînent derrière elles les plaintes
affreusement nasillardes de leurs petits. Et parmi ces paquets de laine
qui courent au milieu des pierres, on cherche un être humain. Bientôt
on aborde un grand trou qui mange la colline et se prolonge en murs de pierres
posées les unes sur les autres. En surplombant l'enclos, on perçoit
trois femmes accroupies en train de traire. Elles portent des vêtements
noirs sur des robes colorées. À notre vue, elles tourneront
leur visage de peur qu'on ne les fige en plein travail dans une photographie.
Chaque bête attend son tour et les jeunes femmes s'affairent sans
relâche dans leur trou. Il y a autour d'elles tant de corps souffrant
d'impatience qu'on se demande quand ces trayeuses trouveront le temps pour
souffler et s'extraire de leur enceinte. Nathalie va s'adresser au seul
homme de la petite communauté, demande si elle peut traire elle aussi.
L'homme acquiesce en souriant sceptique. Elle descend dans l'arène.
On lui offre une place, on lui explique comment s'y prendre. Nathalie tire
sur les mamelles comme sur du caoutchouc. Rien et rire général.
Georges voudrait essayer à son tour. Jet blanc plongeant dans le
seau. Pendant tout ce temps, les autres brebis pousseront sur les murs pour
échapper à l'odeur de l'étranger. Et nous avons repris
notre marche vers le haut par le chemin des collines. Devant une entrée
dans la pierre (c'est là qu'ils doivent nicher pour leurs nuits),
une fille en vêtement rouge nous regarde passer. Je n'arriverai pas
à lire dans sa tête. Non, ça jamais.
Personnages
Nathalie marche comme à la campagne, ou comme en bord de mer, avec
des pensées de citadine, là où le paysage fabule avec
ses verts d'oasis ou ses déserts à n'en plus finir enveloppés
de ciel. Elle aura comme ça déambulé des heures en
compagnie de Georgina commérant sur des aventures savoureuses qui
lui seraient arrivées, sans aucune attention pour la cigogne en vol
de ronde, ni pour les somptueux jardins traversés. Parfois, elle
orchestrera son pas avec celui du guide, si longuement que les langues finiront
par s'agiter. Ça amuse de la voir ainsi forcer l'homme à lâcher
sa piste d'autant que le plus pur est souvent vite dupé, vite ramené
au bon endroit de son humanité. C'est que Rimsa (nom du guide) fera
ses prières, seul ou bien en compagnie des muletiers, avec tout le
sérieux qui convient au sacré. L'ayant surpris parfois certains
matins, agenouillé dans ses phrases, je me suis demandé s'il
n'était pas adepte du soleil. Non pas qu'il prie avec cette poésie
de l'hypothèse qui nourrit d'ordinaire le personnel catholique, mais
ses mouvements de pompe m'ont vite paru comme une manière de médecine
préventive contre l'oubli de soi. Surtout garder la voie pour éviter
la mise en vrac de l'esprit par quelque amoureuse distraction. De sorte
que, déroulement du voyage oblige, nul ne saura jamais si la femme
aura eu raison de notre pilote, vu qu'aucun interstice de temps ne se sera
présenté pour permettre le moindre amuse-gueule.
Georges est mari de Georgette. Ils sont épousés comme deux moitiés symétriques. Manches d'un même habit. Dans une foule, on les prélèverait sans se tromper comme deux âmes touchées par la même grâce amaigrissante, c'est sûr. Imaginez-les chanter des airs de grande béatitude, le corps en voix, et le reste du temps passer dans le sacré service aux autres. Vétérinaires tous deux, ils travaillent dans le vif, la chair palpitante, le sang de vache ou le grouillement des bactéries. Mais c'est pour manger qu'ils font ça, et pour nourrir leur progéniture. Car le reste du temps, toujours le même, ils reçoivent leur manne de quelque chose plus haut, une farine spirituelle qui ne serait pas étrangère à la pâleur de leur teint. À Paul, l'instituteur à la retraite, obstiné comme retraité sans ressort, tellement qu'il cherchera tous les moyens pour traverser les rivières sans se mouiller les chaussures, sur des pierres, pieds nus ou par la voix des airs, Georges offrira son bras, puis son dos. Et quand, à l'heure du repas, le récalcitré fera retraite loin de nous pour se sécher les pinceaux, Georges lui portera lui-même sa pitance. J'avais dit non à ma femme qui voulait m'envoyer danser sur les pierres jusqu'à lui et que je lui remette son assiettée de thon-salade. Georges s'était aussitôt proposé. Charité oblige. Le réflexe avait bien fonctionné, au quart de tour.
Le chef des muletiers
Il est homme à tout faire. Le préparateur des repas, c'est
lui. Le réparateur des corps. Le sourire édenté. L'œil
du maître. Souvent il se met à chanter. Il chemine en savates,
turban et djellaba, avec nous, laissant les autres aller sur les mules.
Aux gens de rencontre il s'offre, tous des frères, surtout quand
échoue sur le camp un voyageur seul, un patriote dans le même
bain, qui vient de loin et qui s'éloignera à perte de vue,
transportant du bien à fourguer de village en village, par ces vallées
sans route, en quête de petits bonheurs ou de petites providences.
Viens boire une tasse de thé, tu reprendras ta route après
! Et l'homme, plongé dans l'absurde et la fatalité, voit dans
ce cadeau un don d'humanité, une bribe qu'il boit comme un bel hymne
à son pays. Ahmed, c'est le chef d'orchestre. Il tire sur les cordes
et il graisse les rouages. Un bon preneur de décisions, précis
et prévoyant. Les autres ont des agissements de soldatesque, mais
lui seul occasionne les mises en train. Reste que le plus curieux dans tout
ça, c'est son style sympathique, de rieur dépouillé
plutôt que robot, jamais figé dans une bouffonnerie de commandant
en chef.
Et si j'étais là pour apprendre
à ne rien bâtir ?
Pauvre gaspillé, pauvre vraiment
qui écris pour maquiller tes organes,
pour faire briller ta laideur, ta vie et tout le reste avec du paradis en
mots.
Ici la pauvreté trouble.
Le vide stimule en toi des vibrations oniriques.
Le vide qui fait anesthésie de tout.
On est dans le friable et dans l'adulation comme un imbécile.
Ce qu'on regarde fait jouir, quoi ? si profondément
qu'on sent grimacer en soi le faux et le mimétisme.
Les cités délugent tant de jacasseries
qu'on cherche soi-même à dire du charabia.
La bête va s'empiffrer de mêlasseries modernes.
Mais c'est l'acte sans voix dans le chant le plus nécessaire
que je veux bâtir.
Non me bâter de fadasseries délirantes.
Non, en vérité, non, pas ça.

Le second campement
Nous avons marché dans un lit fantôme, vidé de sa rivière.
Sur une des rives, à peine une habitation montrant le bout de son
toit au sein d'une élégante profusion végétale.
Au-dessus, danse une falaise, toute en dentelle menaçante. On est
dans l'ocre, le grenat et le mauve que le jour finissant accentue. Viennent
à notre rencontre deux cavaliers concertants, fins comme des lames,
en trottinant tranquille et allure régulière. On voudrait
les prendre en photo. Dollars ! Dollars ! lancent-ils, sitôt saisie
notre intention, la main dressée pour repousser nos tentatives. Ils
n'auront ni billets, ni photos, et puis qu'ils aillent se perdre dans l'infini
avec leurs claquements de sabots sur les cailloux. Nous pénétrons
bientôt dans une végétation si dense qu'un homme y tournerait
en rond jusqu'à épuisement. Mais non, car tout à coup,
devant nous, le plateau. Nos muletiers s'affairent à dresser les
deux tentes : notre cuisine et notre salle à manger. Rien qu'à
lever la tête, on s'aperçoit qu'on est au cœur d'un carrefour
à trois entrées. En examinant la ligne des crêtes, on
reconnaît trois couloirs que les eaux empruntent forcément
à la saison des pluies. J'imagine avec quelle jubilation les torrents
devraient confluer là et entremêler leurs forces. Pour l'instant,
c'est une voie à l'usage des hommes. Et effectivement, avant la nuit
tombée et au lever du jour, il en viendra de partout, à pied
ou bien à dos de mule. Salamalec par-ci, salamalec par-là,
et on se perd de vie à jamais. Dans ce fond de trou surélevé,
chacun cherche à placer sa tente. Mais une pluie suffirait pour se
trouver éparpillé et parti à vau l'eau, une pluie de
tonnerre de Dieu comme il en tombe ici, et notre programme aventurier envasé
en quelques secondes. Les mules sont loin, elles ont déserté
nos odeurs, parties quêter le parfum des quelques herbes qui tentent
là une apparition, si loin qu'il faut les ramener près du
camp, histoire de les avoir à l'œil. Et nous autres, pauvres
humains à merde, on se demande où se cacher pour se lâcher
le cul. À peine a-t-on repéré un coin qu'on y aperçoit
déjà un accroupi au-dessus des herbes. Se soulager, se soulager,
impératif du corps que la pudeur met en rage.
Bijour
Muletier pour l'occasion et le meilleur des hommes, Bijour est un racorni
avant l'âge. C'est qu'il en fait bien quinze de plus avec ses petits
yeux malades, un bon soixante-dix ans avec son corps charogné et
sa peau de presque cadavre. Appelé comme ça parce que chaque
matin il vient nous serrer la main à tous en nous souhaitant le bonjour.
" Bijour ! Bijour ! " qu'il nous lance avec son regard d'eau croupie
rajeunie par l'averse. Or, ce soir-là, Bijour va nous maroquiser
comme des bourriques. Un vrai chef à taper du tambour, chanter, danser,
aller, retour, tourner en rond, dans un sens et dans l'autre, comme un débourré
de quinze ans, qui a la célébration dans les nerfs en dépit
d'une haïssable existence. Et quant à nous, les autres qu'il
faut rendre à la fraternité universelle, venus d'un ailleurs
perverti par les convenances et les habitudes de confort misérable,
nous voici aspirés par de la chansonnette à tambourin, et
romanesque, où il est question de la fille qui dit non au garçon
qui en veut. On se débride, on frappe des mains, on brode un charabia
brouillé par le mimétisme, on se laisse délirer, emportés
sous la houlette du petit diable qui nous a tous contaminés. Au bout
d'un certain temps, on finit par gentiment s'impatienter, on attend la fin
de la rengaine, on l'espère, ça oui, on l'espère, car
on a tous faim, et Bijour, qui fait la sourde oreille, remet ça pour
que chacun en ait son content, rien que pour nous ravir. On ne se nourrit
pas que de pain, mais aussi de bon temps. Ce soir-là, on nous servit
du tajine de mouton, après une soupe aux épices passionnantes.
Aube du second campement
Premier levé, j'ai marché vers le nord, l'œil sur les
pierres d'un vaste lit déserté. Un silence de rêve géologique,
pas le verbiage concentré des abominables villes. Aujourd'hui où
j'écris ces choses, je me demande encore si un seul chant d'oiseau
était venu frapper mon oreille. Traversant ce lit pour grimper sur
la rive en quête de petit paradis hygiénique, bien isolé
du monde, j'entends soudain des mots faire irruption dans ma quête.
C'est un couple avec enfant qui chemine sur l'autre versant en remontant
la vallée. Ils s'arrêtent un instant, l'homme se met à
faire du feu. S'ils s'installent, ils me verront prendre la posture du déféquant
où que je me cache. Leurs mots résonnent en frappant les flancs
des montagnes. Mais ils repartent, et je les vois s'éloigner avec
soulagement tellement la presse est impérieuse. Enfin, je trouve
mon lieu, je le chéris de m'avoir rencontré, et alors que
mon corps rugit déjà de ce succès, le campement tout
entier disparu à mes yeux, je vis des minutes de pure contemplation.
Tel quel
dans ma posture de déféquant
je ne me laisse plus prier.
Grande est la débâcle et mystérieuse la force,
au ventre d'une lumière qui sourit en douceur
à cheval sur les crêtes.
Ici je me démerde,
dans ce carrefour à trois branches,
avant les torrentielles diarrhées de printemps.
Effervescence des plantes,
joie végétale au milieu des pierres
que j'imagine comme un paradis.
J'imagine ce paradis, je l'imagine, je le lis
aussi bon que mon plaisir à me vider
de l'inquiète matière qui faisait poids et pression dans le
ventre.
Qu'est-ce que ce lit de rivière que je peine à remplir?
Et pourquoi ces inconnus de passage sur l'autre rive ont allumé un
feu
pour aussitôt repartir sans en avoir joui ?
Un feu resté comme une force mystérieuse
sur l'autre rive
d'une rivière encore à venir,
allumé par un homme,
sa femme et son enfant assis sur leur mule.
Muletiers en prière
Au matin, sitôt levés, nos muletiers ont rejoint le guide,
retiré dans un coin et déjà en posture de célébration.
Du moins, ceux qui ont l'esprit en amont des choses et qui croient au Pouvoir
exécutif de l'entreprise universelle. Plusieurs fois, ils se sont
prosternés, politesse absolue envers l'irréfutable fatalité.
Et vrai, à ce moment-là, comme je les ai enviés ces
simples, instituteurs de joyeux dénuement, ni jésuites, ni
kabbalistes, qui n'iront pas vous dégueuler du religieux aux oreilles,
non, surtout pas. Leur appétit de Dieu est le pain qui manque à
leur pain quotidien. Un soir, à l'heure du thé, Georgina fera
irruption sous la tente en nous jetant une information de première
importance comme du biscuit sec à nous casser les dents. Vous savez
quoi ? Nos muletiers, ce qu'ils mangent, eh bien c'est nos restes ! Ça
veut dire qu'ils ne préparent rien pour eux. S'il reste des choses,
ils mangent, sinon rien. L'annonce nous fera tous grimacer. Pas un qui n'éprouvera
sa bouche comme une immonde hyène avaleuse. Après ça,
sûr qu'on s'efforcera au partage. Effectivement, les jours suivants,
nos instincts d'affamés feront un hommage particulier à tout
ce qu'on nous servira.
En route vers l'est
Devant nous, c'est l'étendue profonde. Nous allons voir comment tu
vas crever, animal ! Au fond, vers ma propre mort, au prix de cette beauté
qui me cache sûrement quelque chose. J'entre dans une immense gueule
géologique, pas visqueuse du tout, mais grinçante et qui craque
sous les pas. Sa langue est rousse à perte de vue, là où
il n'y a aucun passage visible. Le guide a beau dire et montrer. Vous voyez
ce creux entre deux monticules, etc. C'est de la terre tellement ravinée,
torturée dans tous les sens, qu'on a du mal à percevoir une
ouverture. Et comme on a du mal, on ne sait plus vers quoi l'on avance,
le regard coincé par le goulot qui aspire nos pas, tandis que le
plateau contrarie cette angoisse de cul-de-sac en gardant écartées
les montagnes comme deux jambes. Ce coin-là est inhumain. Quel village
pourrait-on rencontrer ? Étendue si paumée que l'épreuve
d'y vivre pour un homme serait d'un absolu spirituel, avec réduction
du nécessaire à la portion congrue. Pourtant, dans les creux
du terrain, on entendra brailler des moutons ; sur des hauteurs, des trous
dans la roche nous seront indiqués comme des habitations troglodytiques,
occupées tout le temps que dureront les pâtures ; quelqu'un
aura même eu l'audace de construire une villa imbécile, avec
jardin en espalier s'il vous plaît, sans doute pour ne pas vexer le
désert. Et quand nous ferons la pause, histoire de grignoter du fruit
sec en tournant sur nous-mêmes pour contempler le paysage en panoramique,
il en viendra de partout, des hommes, sortis des plis et des creux du terrain,
comme s'il les engendrait, des vieux à cheval, des enfants à
pied, des chiens, des demandeurs de cigarettes, bergers de Berbérie,
trop nègres et trop assimilés à la maigreur du sol
pour vivre avec lui le vrai mariage passionnel que nous autres, trop avares
ou trop vierges, tentons d'atteindre à longueur de déambulations.

Personnages
Avec quel air de triomphe Gina s'est présentée à nous
comme une mère de trois enfants, volontairement célibatairisée
le temps d'un petit voyage ! Le temps de laisser en jachère sa martyrologie
matrimoniale pour aller voir le monde au-delà de son fer à
repasser et des barreaux de son lit. J'estime que j'ai aussi le droit de
me divertir un peu. Sicilienne du sud par son père, faut pas venir
lui chatouiller son ombre. Et comme on peut s'écœurer à
marcher trop longtemps et trop seul dans sa propre voix, fût-ce au
milieu de compagnons bédouinant avec application, on cherche vite
à s'accrocher aux pas d'un autre pour bavasser ou s'envoyer des mots,
histoire d'alléger le train-train. Gina vous araigne en vous engluant
de petits fils soyeux, flatteuse qui a l'appétit des concierges et
le style du pêcheur de truite. C'est dire comme elle sait vous appâter,
et vous tirer à elle sitôt qu'elle vous a accroché,
vous sucer, aspirer vos histoires, quitte à relancer l'intrigue par
de menues questions, du genre : Ah ! mais on voit que tu as beaucoup voyagé.
Ou bien : Tu en en as fait des choses dans ta vie ! Ou bien encore : Mais
alors tu écris et tu peins ? C'est ainsi qu'avec Nathalie, elles
chemineront en tandem, des heures durant, parfois la journée tout
entière. Sans compter que sous la tente, elles ont encore de quoi
s'affrioler, l'une en racontant comment elle affolait ses amants, l'autre
en restant toute oreille, comme une gourde figée dans la gélatine
du mariage. D'ailleurs, ça m'énerve toujours de les voir à
deux comme des copines déambulant sur un trottoir de ville, maintenant
si indifférentes à l'exotisme du lieu que c'est rendre plus
désert qu'il n'est ce désert-là. Une fois, Nathalie
jacassant et gesticulant, l'œil enflammé, étouffant des
éclats de rire avec les mains, Gina aura su interrompre l'emballement
du récit pour se tourner vers moi, toujours à traîner
derrière, et s'excuser de leur si pressante conversation. Ce sont
des histoires trop personnelles pour être partagées. N'est-ce
pas !
Description critique du paysage
Ni montagnes, ni collines, ces terres qui ondulent sur la droite, ce sont
des plis de gros velours posés en vagues bien dodues, sommeillantes
et pachydermiques, comme de la panse monstrueuse digérant les siècles.
C'est que le ciel, pureté énergique, n'aura cessé tout
ce temps-là de pilonner les chairs terrestres avec l'acharnement
d'une haine massive. Dès lors, comment croire à la délicieuse
candeur céleste qui domine ordinairement ces régions. Les
pluies ont râpé le manteau supérieur jusqu'à
la corde. Et ce que nous voyons aujourd'hui ressemble à une trame
de fils en nuances de gris, courant depuis les crêtes, épousant
les bosses et les creux, dans un dégradé qui ferait croire
à une peinture. Qui a fait ça si délirant et si serein
qu'il encourage l'imagination à féconder toutes sortes de
fantaisies, ouvertes à tous les possibles ? Qui ? Il n'y a pas fresque
à nos yeux plus grande, ni plus vivante aux mains du temps. C'est
un écoulement chaotique qui court au fil de l'horizon, et qui donne
aussi l'impression de se déverser transversalement en dévalant
les pentes. De sorte que, à marcher l'œil devant, j'éprouve
comme une ivresse à recevoir sur ma droite les vibrations dynamiques
qui animent ces reliefs et qui s'entrecroisent dans mon esprit. C'est ça
! ça dont je suis la proie, du figé qui vire aux tourbillons
et qui me monte à la tête.
Je n'ai plus la tête à moi, dit le stupide voyageur.
J'ai mené jusque-là une vie parmi les hordes,
une vie donnée aux abattoirs du travail, des lois et de l'argent.
Demain, ma débandade spirituelle terminée,
je serai de nouveau confiné aux refrains tapageurs des sillons.
Mes maîtres chanteurs ne bougeront pas.
Ils ont aboli les règles,
fripouilles illusionnistes qui se font oublier
en nous fourrant du bonheur plein la gueule.
Ainsi, qui croit voyager loin n'est qu'un niculé de plus,
un dépenseur indispensable, pensé plus vite qu'il ne pense.
Fais-toi plaisir, petit, fais-toi plaisir,
dit le marchand d'aventure, va où beau te semble, visite l'intouchable,
les pays sans hommes, où Dieu se montre dans le rien.
Va comme tu veux et reviens nous pour qu'on te bouffe et te baise, coco
!
Je vais, l'esprit boutonné comme un lassé de suivre le train
général
et qui sait bien que là encore
c'est le même travail qui fait marcher l'amoureux des paresses.
Quelle oasis d'après désert surgira
moins haïssable que tous les crimes, empoisonnements et ghettos
de nos cités gâtées d'orgueil ou d'atonies !
Une sacrée rencontre
On a fini par quitter ce désert, on emprunte à présent
une voie montante, on souffle, il devient lourd tout à coup de grimper
après le paresseux chemin qui sinuait, se perdait ou resurgissait
devant nous. Eh bien, au plus fort de la côte, une fille est apparue,
une du même pays que le nôtre, un ange flanqué d'un guide,
d'un muletier et d'une mule, tout ce petit monde à contresens. Ça
nous a tous figés sur place de tomber par hasard sur cette aventuresse
pérégrinant comme on ferait son marché avec chauffeur
et domestique. Nos yeux agglutinés sur elle, nous l'écoutons
se soulager de mots trop longtemps contenus. Sa peau rouge bonbon paraît
presque brûlée malgré le turban qui lui empapillote
la tête. Elle n'arrête pas de raconter son histoire, et comment
elle en est arrivée là, à sillonner ce bout de terre
qu'elle voulait savourer au plus profond, et comment elle doit supplier
ses hommes qu'ils lui traduisent les mots échangés entre eux
avec un air de comploter. Et chacun de nous, sûrement, de se demander,
dans son diabolique for intérieur, si la petite écervelée
occupe ses nuits sous la tente à écrire à maman pour
la rassurer, à mourir de peur qu'on ne la viole, à dormir
profondément, écrasée de fatigue, ou bien à
espérer une gâterie de septième ciel pour laquelle elle
aurait payé après tout. À coup sûr, ce sera toujours
au désert que reviendra le soin de comprendre les femmes, pas aux
hommes.
Les marcheurs partis pour marcher
ont la bravoure cafardeuse.
Constipés d'économies qui coagulent leurs moindres divagueries,
ils marchent à se déchiffonner la tête.
Et voilà qu'ils dépriment sur les pierres dressées
en foule,
eux qui s'accrochaient au terrain
pour éprouver les vertiges d'une certaine virginité.
À l'ombre d'un rocher, ils s'affaissent.
Pierre de haute taille surgie de terre comme une main
de Commandeur.
En contrebas, une bergère adolescente a tourné les yeux
vers eux pour savoir qui vient ainsi lui tracasser le silence.
Elle a des yeux d'un noir laineux
et ses moutons cherchent l'herbe entre les pierres.
Elle s'approche, mais tiendra farouchement ses distances.
Et les marcheurs plus secs
repartiront de plus belle avec leur goût bourgeois de la justice.
Autoportrait en marcheur de fond
Pas d'autre credo que celui de chercher une eau claire dans l'escroquerie
qui ravage le monde. Tous, nous avons ça dans la tête, cette
connaissance des causes, valise au fond des valises, qui fait aller par
monts et par vaux. Mon chapeau a de larges bords, et pourtant, je protège
ma nuque avec un foulard, on ne sait jamais. Lunettes en miroir, sac à
mille poches et courroies, chaussures à semelle renforcée,
j'ai l'air d'un baroudeur qui transporte ses poisons au beau milieu d'un
paysage thérapeutique. Petit Poucet, toujours à traîner
derrière, mes jambes trop courtes m'empêchent de tenir le rythme
des grands. Vu de dos, je fais déménageur, croupe de vache,
boxeur allant au combat, marin de chalutier, berger andin courbé
sous le poids du malheur. C'est dire aussi pourquoi je préfère
me mettre en queue, pour ne pas avoir à offrir le spectacle de ma
démarche paysanne. De fait, en évitant de me mettre en avant,
je peux laisser mes yeux aller où bon leur semble, dans les directions
les plus curieuses, sans avoir l'inquiétude du chemin quand il entre
en labyrinthe, ni celui de l'allure pour retenir ou entraîner le groupe.
Par-dessus tout, ce sont ces départs au lever du jour qui m'enthousiasment
le plus, quand, juste après le petit-déjeuner, le soleil inonde
notre camp et fait fuir les froidures de la nuit. Nous marchons alors comme
vierges à la rencontre de choses qui vont entrer toutes pures dans
notre esprit, tandis que nous allons vers du jamais vu, lieux qui dissolvent
en nous quelque chose, on ne sait quoi : relents de villes, résidus
d'hypocrisie, rancunes surfaisandées… On ne dira pas assez
combien on se lave rien qu'en marchant. L'étonnement qu'on a perdu
dans l'ordinaire de sa vie revient. L'adoration aussi, et la reconnaissance,
et l'impression que la terre est habitée par des dieux invisibles,
comme dans la croyance des Grecs, entourés par tant de splendeur
qu'il leur fallait bien inventer cette présence surnaturelle dissimulée
derrière les choses. Je marche trapu, les bras ballants, les mains
gonflées d'un sang qui s'accumule, j'agrippe le sol de mes pas, mes
épaules en force comme un nageur qui arrache les flots. De fait,
si je nage, c'est de jouissance, mon esprit n'a nul besoin de filtrer l'inconnu,
tellement la terre ici, à l'écart des chemins, sera restée
elle-même.

Je cherche en marchant l'oasis,
l'oasis promise à mes yeux.
Jusqu'à quand marcher comme ça,
en naïf imbécile, à cracher mon sel et ma sueur ?
La ligne blanche des Atlas nous tient sous sa coupe.
Toujours elle, à nous narguer debout devant,
masse de pierre et mère des pierres sur nos chemins.
Ça fait des heures que nous déambulons, ciel denté,
et toujours rien pour nous sortir de ce monstrueux pittoresque.
Rien qu'une charade sans forme sur le sol.
Personnages
Ce Jean, c'est fuyant comme une eau dans la main. Un effacé, avec
un âge mal fait pour l'exubérance ou les blagues. Enseignant
il fut, maintenant il marche. Ça tache dans le groupe son vert de
chemise. La voir se promener sur les fonds ocre des plateaux nous le rappelle
aussitôt à la mémoire. C'est qu'on l'avait oublié.
Ah ! oui, Jean, ce chapeau, ces lunettes et surtout ce vert criard qu'il
porte largement sur le dos ! Il y a des gens qui ont un marcher sec, parlant
peu, ne se racontant jamais, réservés et glissants. Le nôtre
garde les pieds dans ses chaussures, au-delà l'existence pourrait
se compliquer. Le seul à ne pas avoir d'appareil photographique.
Il est resté sur ma table. Peut-être qu'il ne voulait pas venir
avec moi. Mais alors, croyez-vous qu'il demanderait à quelqu'un de
lui tirer le portrait au cœur de ces contrées exotiques, histoire
de ne pas quitter le pays sans une preuve de son passage ? Du tout. Il aurait
bien trop peur de jouer à l'intrus… Il y a des gens comme lui,
pas laboureur, ni exalté, qui ne laisse pas de trace. Sans doute,
se voit-il trop âgé pour nous ! Il mange, il dort, il marche.
Le soir où nous avons dansé à la marocaine, tous pris
par la contagion des tambourinades, il était resté mou, à
peine un sourire, plutôt un étonnement. Un frigide, un amputé,
un imperméable, insensible aux dandinements de Bijour, viande salée
par l'usure de l'âge mais tout de même vivante. L'idée
m'est alors venue que Jean est un sans femme… Célibataire,
veuf, séparé, divorcé ou autre, enfin une de ces variantes
ou plusieurs à la fois... Et puis, c'est à se demander si
le paysage lui rentre dans le corps, le remplit, l'amplifie, fait naître
en lui une émotion particulière. Je ne le vois jamais en arrêt,
saisi par une extase. Au contraire il vous montre une face un peu bête
comme celle d'un être moulé par les habitudes, même quand
les choses pavanent comme en ces lieux. Mais alors, me direz-vous, quel
intérêt aurait-il à se torturer les pattes sur ces cailloux
? Il vit ses heures comme s'il distrayait son ennui, cette assurance de
satisfaction chèrement conquise, d'une année sur l'autre,
à coup d'années laborieuses et interminablement contrariées.
Artiste de sa propre conservation, œuvrant dans le reconnu de peur
que le grand trou ne l'avale. Une fois, en cours de route, je me suis approché
de lui, avec l'idée de lui dénouer la langue. À peine
si j'ai su qu'il habitait Grenoble. Plutôt les nouveaux quartiers,
savez-vous ? Et puis, coquetterie de sa part ou je ne sais quoi, il a bien
voulu que je le prenne en photo, une photo que je lui enverrais. Il a tenu
la pose, avec un air de Tartarin, le pied gauche posé sur une grosse
pierre, il avait tué son lion.
Bijour
Hier, à la veillée entre eux, les muletiers ont fait parler
Bijour sur ses amours de quatre femmes. On joue les étonnés,
on a des sourires frivoles, des curiosités vicieuses. Voilà
qu'un homme tout à fait achevé, jouisseur de petits biens
précieux, parti sur les routes comme une jeune recrue, mais séché,
ridé, parasité par le besoin, en serait à sa quatrième
épouse, une ardente à la trentaine qui lui aurait donné
son premier enfant, un fils. Son hors-d'œuvre en mariage, c'était
affaire de parents, un arrangement entre eux qui a mal tourné. La
seconde se débattait pour ne pas faire l'amour comme à la
télévision. On lui demande de bien regarder, rien à
faire, ça ne venait pas. Quant à la troisième…
une stérile. On ne se voyait pas bouché à vie, à
s'ébullitionner la mécanique par des histoires de grossesses
nerveuses. La dernière serait la bonne, une qui montrerait à
tous qu'on n'est pas encore faisandé, ni vaincu par sa soixante troisième
année, mais plein de pression au contraire, et d'une pression qui
compte bien se répéter.
Premiers verts
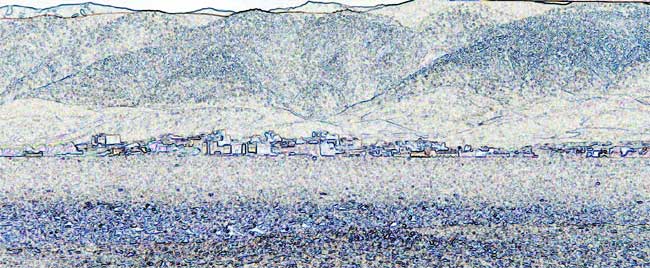
Maintenant, au loin, des lignes de poussée verte coulent comme du fleuve à fond de vallée. Sous les masses de sanguine ici et là révélées par l'usure, percent les premiers arbres aux abords des bâtisses, des tours, des totems électriques. La montagne décline en douceur ses pentes avec des plis et boursouflures. La montagne glabre, et grasse, qui largement s'étale jusqu'à se tendre vers l'extinction de ses formes. Notre chemin à prendre jusque là-bas, on le reconnaît, trace blanche ou mince filet qui court au gré des reliefs. Deux petites filles nous regardent à distance. Bientôt les enfants seront dix à nous suivre et harceler aussi longtemps que nous tiendrons.
Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo !
Donne-moi un stylo !
Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo !
À la longue, ils se collent à vos godasses. On se demande ce qu'ils ont tous à croire que l'étranger n'est qu'un souk occidental, qu'un sac à dos recèle des objets magnifiques, venus d'un monde conquérant. On est à deux doigts de se rendre. On voudrait bien, voudrait bien ne plus ruser, et que l'ultime obstinée, jeune fille d'environ dix ans, recueille le fruit de son obstination. Mais on craint aussi que l'enfant ne délire sur nos bricoles et que sa réalité finisse par dérailler avec nos minuscules pyramides, sans voir toutes les fatalités économiques qu'il a fallu pour nous fabriquer ces petits trucs à bourrique, notre ordinaire extatique et dévorant.
Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo !
Donne-moi un stylo !
Donne-moi un stylo ! Donne-moi un stylo !
Aux abords du grand marché, quelques désœuvrés font table rase au-devant d'une piètre taverne. La terre à cru fait ruelle. Après-midi stérile, les marchands sont partis. Place vide, échoppes closes tout autour. Un vieux légumier, seul, vend de gros oignons, des oranges et des herbes locales. L'odeur de tripes tient à la terre malgré le ciel qui pompe tout, prières et crasses. On imagine quels bruits de ventre furent là ce matin. Venus de toutes les montagnes environnantes, clients et marchands ont occupé le lieu, leur théâtre vital.
Nous marcherons encore, d'abord longeant des murs, puis à découvert
dans le paysage rural. Nous côtoyons bientôt une rivière,
des jardins naissent à mesure, des filets d'eau tentaculent de toutes
parts. Un village se montre, bâtisses dressées en espèce
de remparts jaloux, c'est le signe que la vie n'a pas d'autre rêve
ici que la vie même. Un minaret à liserés blancs, chandelle
debout, fatigue le regard avec sa fausse allure mystique et son air en cou
de girafe. C'est le début des oasis, des eaux et des jardins.
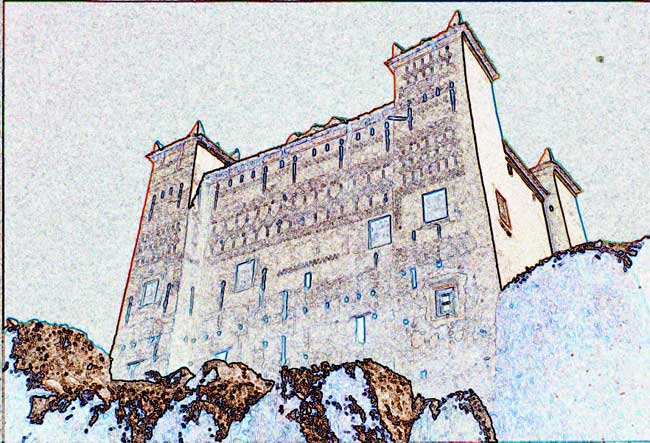
Le troisième campement
Passé la rivière, derrière les vorgines, les tentes
sont là pour accueillir nos fatigues. À peine avant la nuit,
nous pénétrons dans le village, à l'heure où
les hommes convergent vers leur minaret en prière. Des bruits de
tambourin bavardent à nos oreilles. Nous coulons dans les ruelles
vers la source des intrigantes sonorités, tellement est grande notre
avidité à saisir les astuces que les gens d'ici déploient
pour nourrir ou noyer leurs instincts. Il y a foule, des jeunes et des femmes,
l'obscurité gagne la place. Sur une aire en contrebas, dansent des
adolescents. Une rangée de filles face à une rangée
de jeunes garçons. L'une avance, l'autre recule, à tour de
rôle. C'est le jeu cadencé de l'audace et de la timidité
à travers lequel les regards s'échangent et les corps se désignent
mutuellement. C'est méticuleux et équilibré, rien à
voir avec nos gigoteries délurées qui décapitent toute
sublimation et font férocement grimacer les faciès déformés
par l'infernal de leur frénésie. Pour nous autres, qui demeurons
à mille lieux de ces formules que nos frères en humanité
ont inventées contre l'avarice des jours rien que pour partager de
l'intime et du personnel, tout ça nous envahit d'émerveillement
et de tristesse. Mais comme c'est beau ces chants alternés qui demandent
l'autre, dans ce village à court d'électricité, aux
venelles pénibles, dont la terre battue par les pas fait pitié,
où tout respire une cruauté sadique.
Au matin, premiers appels à la prière, je suis levé, poussé au ventre par la quête d'un petit coin. Je déambule dans le lit mort d'un bras d'eau dont le flux fut diarrhéique, comme une tyrannie du poids et de la pression si ravageuse qu'elle creusa la chair du sol profondément. Accroupi sur ma délivrance, j'observe le ciel qui me recouvre de sa pureté quand tout à coup une cigogne vient laver mes grimaces rien qu'avec son vol. La voix de l'inconnu vers Allah crève le calme spirituel du lieu comme une atroce reconnaissance. Je sors de mon trou, une femme porte un fagot. Le village bruit de ces mille petits affairements qui froissent le silence. Des chiens aboient.
J'ai crotté sur la terre,
ravi par le ciel vierge qui n'assomme pas.
J'ai trotté dans ce beau qui n'est ni forcené
ni braillard. Pourquoi l'homme a-t-il ce désir d'ablution ?
Ni luxe technique, ni dressage économique
ici. Ni le gâchis des prétentions absurdes.
Les enragements modernes m'ont pris tellement
que ma vie m'aura filé entre les doigts.
Avaler tout ici-maintenant plutôt que voir vautrer mon bien
dans la saoulerie des doctrines marchandes.
Personnages
Le sourire tragique de Joseph, rougissant célibataire, ses yeux fades cachant on ne sait quelle mystique, c'était le signe d'un petit-vivant-bourgeois, ne cherchant ni les honneurs ni les flatteries, mais le respect naïf du monde. Un temps, nous avons cheminé côte à côte en quête d'affinités. Comptable dans une administration parisienne, il me donne l'impression de la bonne pâte, jamais dissonant, de l'agent zélé penché à longueur de jour sur le nécrosant des chiffres qu'il doit dessiner en pattes de mouches, pas le gars travaillé d'exotisme, mais de l'espèce vivisectionneuse qui dépiaute minutieusement l'étrange énigme cherchant échapper à son œil diabolique. Et en effet, il m'a suffi de le voir tritouiller sous les pierres pour reconnaître mon entomologiste et l'imaginer possédant assez de curiosité pour s'enlyriquer l'esprit au spectacle de tel ou tel coléoptère local coincé sous son instrument binoculaire. De parler avec lui, le temps d'une marche à travers les jardins, sur les causes de sa dévotion ("Pas les hyménoptères, ni les hétéroptères, ni les diptères, ni les arachnides, ni les arthropodes, seulement et uniquement les coléoptères français de la région parisienne, et plus précisément de la forêt de Fontainebleau.") m'a fait du bien. Le comptable compte, compare, compile, vérifie et classe, le soir venu, sous la lampe de son bureau. Nous parlons de la cicindèle, demoiselle élégante aux élytres d'un vert velours à pois ivoire. Alors ses yeux rutilent, ses lèvres se fendent et sa bouille de hibou s'éblouit à la seule idée de la petite machinerie poétique aux pattes aussi fines qu'un cheveu, que le bonheur lui fut donné de prendre un jour dans ses filets. Voilà donc par quel ciel ce putassier du travail compensait son enfer d'englué valet. C'était ça le suprême de son extase, le frisson qui l'exaltait autant qu'un autre un corps de femme ou l'esquisse d'une communion avec Dieu. J'avais réussi à lui sortir de la bouche une confession par bribes sur toutes ces choses qui font l'ordinaire de sa jouissance. Ce n'était plus, à mes yeux, ce marcheur sans parole qui tâtonnait en plein désert, mais un amoureux des mystères dont le monde nous fait confidence.
Etc.
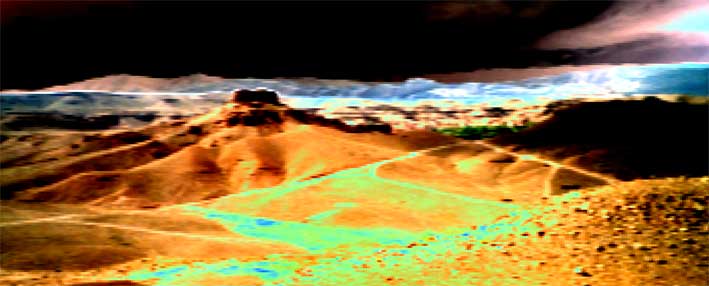
(août-novembre 2000)